Consulter le Booklet de l’événement
A*STAR ID Labs – l’Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche – Infectious Diseases Labs – et l’Institut Pasteur ont organisé conjointement un symposium impliquant le Pasteur Network.
Une délégation singapourienne d’A*STAR ID Labs était présente sur le campus de l’Institut Pasteur les 5 et 6 octobre 2023, dont la directrice exécutive d’A*STAR ID Labs, Prof Lisa Ng, et la directrice adjointe d’A*STAR ID Labs, Ms Amanda Loo. Lors de la séance d’ouverture, Son Excellence Mme FOO Teow Lee, Ambassadrice de Singapour en France, a réaffirmé la volonté de Singapour de favoriser les collaborations de recherche avec la France, et s’est félicitée du renforcement des liens entre A*STAR ID Labs et l’Institut Pasteur.
Un dialogue entre A*STAR et le Pasteur Network a été lancé grâce à la participation d’intervenants du réseau provenant de l’Institut Pasteur, de l’Institut Pasteur de Lille, de l’Institut Pasteur Corée, de l’Institut Pasteur du Cambodge et de l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Le Dr Rebecca F. Grais, directeur exécutive du Pasteur Network, a prononcé un discours d’ouverture sur le Pasteur Network, qui dispose d’un vaste réseau de recherche, de santé publique et d’épidémiologie.

Les présentations scientifiques se sont articulées autour de trois grands domaines de recherche : les maladies respiratoires, les maladies à transmission vectorielle et la résistance antimicrobienne. Ces domaines de recherche constituent des priorités scientifiques pour les laboratoires A*STAR ID et l’Institut Pasteur, ainsi que pour le Pasteur Network.
La première session a donné aux participants un aperçu des recherches en cours sur la tuberculose au sein du Pasteur Network et de l’Institut Pasteur, ainsi que sur la préparation aux épidémies au sein des laboratoires A*STAR ID. La deuxième session s’est concentrée sur les maladies à transmission vectorielle avec un large éventail de sujets abordés, tels que les interactions moustique-virus, la recherche sur les trypanosomes, et la dynamique virale-neuro-immune dans les infections à arbovirus, entre autres. La dernière session du symposium a présenté les dernières recherches sur la résistance aux antimicrobiens menées dans les laboratoires A*STAR ID, notamment sur la thérapie par les phages, à l’Institut Pasteur, par exemple sur le développement de nouveaux antibiotiques, et au sein du réseau Pasteur, sur la lutte en cours contre la résistance aux antibiotiques.
Environ cinquante pasteuriens ont participé aux sessions du symposium. Les présentations des orateurs ainsi que des moments d’échanges ont permis aux participants de discuter de futurs projets de recherche et de collaborations.









À propos de A*Star / ID Labs
Fondé en avril 2021 au sein de A*STAR (Agency for Science, Technology And Research), la principale agence publique singapourienne pour la R&D, ID Labs rassemble des chercheurs multidisciplinaires du monde entier œuvrant à l’obtention d’avancées en matière de préparation et de défense contre les menaces de maladies infectieuses émergentes, une vision partagée par l’Institut Pasteur et le Pasteur Network.
À propos du Pasteur Network
Vaste communauté humaine et scientifique, le Pasteur Network rassemble plus de 30 membres établis dans une vingtaine de pays qui contribuent ensemble à l’amélioration de la santé mondiale. Le réseau, au cœur de zones endémiques, dispose d’un accès privilégié à de très nombreux pathogènes qu’il surveille et étudie sur les 5 continents. Cette exceptionnelle diversité fait du Pasteur Network un acteur mondial unique de la santé publique, de la science, de l’innovation et de la formation, en particulier dans la lutte contre les maladies infectieuses.
Avec pour ambition de promouvoir la collaboration et le partage des connaissances, le Pasteur Network soutient des modules de formation d’excellence, dispensés chaque année. Trois cours, animés par des membres du Pasteur Network, ont récemment mis en lumière certains de ses axes d’action stratégiques, à savoir la veille épidémique et la préparation aux épidémies, la recherche, le développement et l’innovation, la création d’équipes pluridisciplinaires collaboratives et la promotion d’une collaboration équitable.
Un premier cours portant sur la biologie des infections virales émergentes et négligées en Amérique latine (« Biology of emerging and Neglected Viral Infections in Latin America ») s’est tenu du 19 au 28 avril 2023 à l’Institut Pasteur de Montevideo.
Organisé par Nicolas Sarute (Institut Pasteur de Montevideo), Nolwenn Jouvenet (Institut Pasteur, Paris) et Sandra Cordo (UBA, AUGM, Argentine), ce cours a été l’occasion de réunir des chercheurs et professionnels de santé venus de toute l’Amérique latine. Son principal objectif : stimuler la collaboration pluridisciplinaire sur les aspects clés de la biologie des virus négligés et émergents, tout particulièrement à l’égard des pathogènes ayant un impact sur la santé publique. Différents thèmes tels que la recherche fondamentale sur les virus, l’épidémiologie, la surveillance et les stratégies de prévention et de lutte y ont été abordés.
Ce cours portera le nom du professeur Otto Pritsch, un chercheur récemment décédé, qui aura joué un rôle de premier plan dans la consolidation de l’accord signé entre la Délégation régionale de coopération pour l’Amérique du Sud, l’Association des universités du groupe de Montevideo (AUGM), l’Institut Pasteur (Paris) et l’Institut Pasteur de Montevideo.
Consultez le programme sur le site Web de Institut Pasteur de Montevideo
Dans le cadre du projet SARA (Surveillance de l’antibiorésistance en Afrique), un deuxième cours cofinancé par le FSPI du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères a été dispensé à l’Institut Pasteur de Dakar du 22 au 26 mai 2023. Ce cours intensif, coordonné par le groupe de Sylvain Brisse (Institut Pasteur) et Yakhya Diye (Institut Pasteur de Dakar), a rassemblé 21 participants de 9 pays d’Afrique. Portant essentiellement sur le séquençage et l’analyse bioinformatique des génomes bactériens, il a notamment permis aux participants de renforcer leur réseau collaboratif et de partager les « bonnes pratiques » dans les domaines de la surveillance de l’antibiorésistance.
Pour en savoir plus sur le cours SARA, lisez l’article publié sur Pasteur.fr.
Enfin, c’est à l’Institut Pasteur Hellénique que s’est tenu, du 26 au 29 juin 2023, le cours immersif sur l’innovation et le transfert de technologie en sciences biologiques et santé publique (« Immersion in Innovation and Technology Transfer in Biological Sciences and Public Health »). Pendant quatre jours, différents experts ont évoqué l’importance du transfert de technologie et de l’innovation dans le développement et la fabrication de produits médicaux innovants.
Consultez le programme sur le site Web de l’Institut Pasteur Hellénique
En finançant ces cours d’excellence et en les rendant accessibles à un vaste public, le Pasteur Network a pour objectif de stimuler une action collective et le partage de connaissances dans les domaines des maladies infectieuses émergentes et de la résistance antimicrobienne, tout en encourageant l’innovation scientifique.
Pour en savoir plus, consultez les liens suivants :
Liste des cours parrainés par le Pasteur Network
Pasteur Network contact : Kathleen VICTOIR kathleen.victoir@pasteur.fr
L’Institut Pasteur, Fiocruz – Oswaldo Cruz Foundation (Brazil) – deux membres du Pasteur Network – et l’Université de Birmingham (UK) ont créé l’Unité internationale pasteur sur les vésicules extracellulaires fongiques. Les Pasteur International Units sont créées par deux ou plusieurs équipes de recherche qui travaillent ensemble en lien avec le Pasteur Network.
Plus d’information :
- Article de l’Institut Pasteur : Création de l’Unité internationale pasteur su
- r les vésicules extracellulaires fongiques
- Communiqué de presse de Fiocruz : Fiocruz-Pasteur-Birmingham international unit will investigate fungal diseases
Sur le Pasteur Network
Vaste communauté humaine et scientifique, le Pasteur Network rassemble plus de 30 membres établis dans une vingtaine de pays qui contribuent ensemble à l’amélioration de la santé mondiale. Le réseau, au cœur de zones endémiques, dispose d’un accès privilégié à de très nombreux pathogènes qu’il surveille et étudie sur les 5 continents. Cette exceptionnelle diversité fait du Pasteur Network un acteur mondial unique de la santé publique, de la science, de l’innovation et de la formation, en particulier dans la lutte contre les maladies infectieuses.
Le directeur général de l’Institut Pasteur, Professeur Stewart Cole, et le recteur de l’Université de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti Junior, ont signé le vendredi 31 mars 2023, lors d’une cérémonie à Paris, les statuts de l’Institut Pasteur de São Paulo, association de droit privé brésilien sans but lucratif. Cet Institut, membre associé du Pasteur Network, aura pour mission de mener des recherches dans le domaine de la biologie afin de contribuer au développement de la santé humaine, de promouvoir des activités de diffusion des connaissances scientifiques et d’enseignement, d’innovation et de transfert des connaissances, ainsi que d’assurer des actions en faveur de la santé publique.
Pour aller plus loin
Lire le communiqué de presse sur le site de l’Institut Pasteur : https://pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/institut-pasteur-universite-sao-paulo-signent-nouveaux-statuts-vue-creation-institut-pasteur-sao
Photo : Cérémonie de signature à l’Institut Pasteur – © François Gardy – Institut Pasteur


Le 09 décembre 2022 s’est tenu la Cérémonie des Doctorants de l’Institut Pasteur. Trois diplômés représentaient le Pasteur Network : le Dr Habib pour l’Institut Pasteur de Madagascar, le Dr Lyu pour le Pôle de Recherche Université de Hong Kong – Pasteur et le Dr Modiyinji pour le Centre Pasteur du Cameroun. Après le discours d’introduction de l’invité d’honneur, le Pr Ugur Sahin, professeur d’oncologie translationnelle et d’immunologie à l’Université de Mayence et PDG de BioNTech, tous ont eu quelques minutes pour présenter leur parcours.
Dr Azimdine Habib

“Toujours avoir un objectif dans la vie et se donner tous les moyens pour l’atteindre. Ne jamais avoir peur d’un échec mais apprendre de celui-ci pour avancer”
Le Dr Azimdine Habib est originaire des iles Comores où il obtient sa licence en Sciences de la Vie en 2012. Son master en Biochimie fondamentale et appliquée, option biochimie, biodiversité et santé l’amène à Madagascar. Il y intègre l’Institut Pasteur de Madagascar au cours de sa deuxième année au laboratoire de bilharziose. En 2016, il y est recruté en tant que technicien de laboratoire dans l’unité de bactériologie expérimentale. Dès 2017, il commence son doctorat sous la direction du Dr Jean-Marc Collard. Sa thèse explore le lien entre la composition du microbiote intestinal et les parasites intestinaux, notamment chez les enfants atteints de malnutrition. Dans le cadre du concours « Ma Thèse en 180 secondes », organisé par l’Institut Pasteur de Madagascar, Azimdine Habib a présenté sa thèse pour un public non scientifique et obtenu la première place de la 2ème édition. Il a ensuite défendu sa thèse en décembre 2021. En octobre 2022, il a rejoint la plateforme technologique BIOMICS de l’Institut Pasteur, également membre du Pasteur Network, en tant qu’ingénieur de recherche où il s’intéresse au séquençage nouvelle génération.
Dr Huibin Lyu
“La pratique est le seul et unique moyen de tester la vérité”
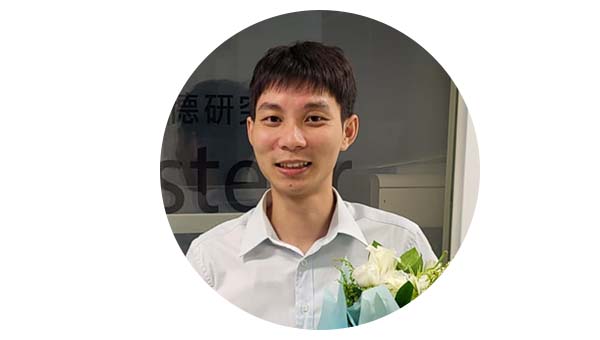
Le Dr Huibin Lyu, Tomas, a démarré son parcours de recherche à l’Université de Technologies de Guangdong en Chine en étudiant les propriétés antibactérienne et antitumorale du curcuma. Cette expérience l’encourage à commencer un second master à l’Université médicale de Guangzhou en virologie et immunologie, plus spécifiquement sur le criblage des anticorps présentant une réaction croisée avec le virus de la grippe. Grâce à une bourse doctorale du programme Calmette & Yersin, Huibin Lyu rejoint ensuite le Pôle de Recherche de l’Université de Hong Kong – Pasteur, membre du Pasteur Network, pour conduire son doctorat au sein de l’équipe du Pr Roberto Bruzzone et du Dr Chris Mok. Sa thèse s’inscrivait alors dans la poursuite de son master avec pour thématique la réponse des anticorps après la première infection grippale chez le nouveau-né et la spécialisation du système immunitaire chez le modèle murin. Face à la pandémie de la Covid-19, le Dr Lyu a réorienté son sujet sur un autre virus, le SARS-CoV-2 et a contribué à une meilleure compréhension de la réponse immune à ce virus. En septembre 2022, il a soutenu sa thèse sur les réactions croisées du système immunitaire face au SARS-CoV-2 chez l’homme et la souris. Le Dr Lyu est aujourd’hui post-doctorant à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign où il cherche à identifier les signatures des anticorps humains contre différents pathogènes.
Dr Abdou Fatawou Modiyinji

“La Science n’a pas de patrie”
Le Dr Abdou Fatawou Modiyinji a réalisé ses études à la faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé 1 au Cameroun. En 2012, il y obtient sa licence de Biologie des Organismes Animaux. Il poursuit avec un master en Parasitologie et Écologie qu’il obtient en 2015. Il poursuit ensuite avec un doctorat au Département de Biologie et Physiologie Animales et au Centre Pasteur du Cameroun, membre du Pasteur Network. Première étude du genre au Cameroun, sa thèse a porté sur l’hépatite E chez les populations humaine mais aussi animales dans le pays. En plus de caractériser les génotypes du virus de l’hépatite E chez les humains, elle a mis en lumière une séroprévalence élevée du virus au sien des deux populations suggérant une transmission inter-espèce du virus de l’hépatite E au Cameroun. Auteur de plusieurs publications durant sa thèse, Abdou Fatawou Modiyinji a soutenu cette dernière en juillet 2022. Il étudie maintenant les entérovirus en tant que chercheur post-doctorant au Centre Pasteur du Cameroun.
Suite à la récente flambée épidémique de monkeypox, des chercheurs du Pasteur Network et de l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes signent un portrait complet de la maladie dans le New England Journal of Medicine. L’occasion de revenir sur les signes de la maladie, son origine mais aussi sur les projets la concernant au sein du Pasteur Network tel AFRIPOX porté par l’Institut Pasteur et en collaboration avec l’Institut Pasteur de Bangui.
Toutes les informations sur cette publication sont à lire dans l’article dédié sur le site de l’Institut Pasteur.
Pour aller plus loin :
Article de l’Institut Pasteur : Variole du singe / MonkeyPox : un « portrait-robot » de la maladie
Review article: Monkeypox
New England Journal of Medicine, 26 octobre 2022.
Antoine Gessain, M.D., Emmanuel Nakoune, Ph.D., and Yazdan Yazdanpanah, M.D.
DOI: 10.1056/NEJMra2208860
Lors d’une épidémie, il peut arriver qu’aucun test diagnostique ne soit parfaitement adapté au pathogène. Pour endiguer le plus rapidement possible l’épidémie, le dépistage se fait alors en utilisant plusieurs tests. L’interprétation des résultats des différents tests devient alors plus complexe, ce qui peut rendre le diagnostic individuel difficile et conduire à une mésestimation de la prévalence de la maladie. En prenant pour étude de cas l’épidémie de peste ayant touché Madagascar en 2017, des chercheurs de l’Institut Pasteur et de l’Institut Pasteur de Madagascar proposent un cadre analytique afin de caractériser la performance des différents tests et d’estimer la prévalence réelle de l’épidémie. Publiés dans la revue Plos Biology, ces résultats permettront d’améliorer la qualité du diagnostic lors de futures épidémies.
Entre août et novembre 2017, 2.414 cas cliniquement suspectés comme porteurs de Yersinia pestis, le bacille de la peste, ont été notifiés, avec une grande proportion de peste pulmonaire. Les échantillons ont alors été analysés à l’aide de trois types de tests de diagnostic : la culture bactérienne, le test rapide de détection de la peste et la biologie moléculaire ou qPCR. D’importants écarts ont été observés entre les différents tests, rendant l’interprétation des résultats complexe. La plus forte incertitude portait sur l’étendue de l’épidémie de peste pulmonaire, les cas positifs variant de 1 % à 18 %. Le cadre analytique utilisé dans cette étude a permis d’estimer que 7 à 15% des cas suspects était porteurs de Yersinia pestis pour cette épidémie.
Estimer les performances d’un test diagnostique
Deux paramètres, la spécificité et la sensibilité, déterminent la performance d’un test. La spécificité est la probabilité d’être dépisté négatif lorsque que l’on n’est pas infecté tandis que la sensibilité est la probabilité d’être diagnostiqué positif lorsque l’on est bien infecté. Lorsqu’il existe un test de référence avec une sensibilité et une spécificité parfaite, il est facile d’estimer la sensibilité et la spécificité d’autres tests en les comparant à ce dernier. En l’absence de test de référence, comme ce fut le cas pour cette épidémie de peste, les auteurs ont dû estimer les performances de chaque test puis la prévalence de l’épidémie. Pour cela, il ont utilisé la méthode dite des classes latentes qui s’appuie sur la comparaison des résultats de différents tests imparfaits. Cette analyse a révélé que la biologie moléculaire avait les meilleurs performances ; et que le test rapide de détection avait une spécificité limitée durant l’épidémie de peste de 2017. Ses performances étaient meilleures l’année suivante, en 2018, suggérant que le contexte de réponse à une grande épidémie peut impacter la qualité du diagnostic.
Combiner les résultats pour reconstruire une épidémie
Une fois connues les performances des différents tests, les chercheurs ont déterminé comment améliorer les algorithmes de classification des cas pour minimiser les risques de faux-positifs et faux-négatifs. Ils ont aussi pu reconstruire, de façon plus fine, les tendances épidémiologiques de l’épidémie dans l’espace et le temps. Une meilleure classification des cas est particulièrement importante pour l’allocation de ressources rares, par exemple en ciblant avec précision les efforts de recherche des contacts là où l’incidence est la plus forte. Cela évite de déployer des ressources en cas de faux-positifs et optimise l’impact des installations de test mobiles.
Si le développement et la disponibilité de diagnostics de haute qualité restent une priorité, ce cadre analytique pourrait être un outil précieux pour réduire les incertitudes face à d’autres maladies infectieuses ne disposant pas de diagnostic de référence. Il est notamment déjà utilisé par l’Institut Pasteur de Madagascar pour diagnostiquer les cas de tuberculose.
Pour aller plus loin :
Evaluating and optimizing the use of diagnostics during epidemics: Application to the 2017 plague outbreak in Madagascar
Plos Biology, 15 août 2022.
Quirine ten Bosch†*, Voahangy Andrianaivoarimanana†, Beza Ramasindrazana†, Guillain Mikaty, Rado JL Rakotonanahary, Birgit Nikolay, Soloandry Rahajandraibe, Maxence Feher, Quentin Grassin, Juliette Paireau, Soanandrasana Rahelinirina, Rindra Randremanana, Feno Rakotoarimanana, Marie Melocco,Voahangy Rasolofo, Javier Pizarro-Cerda, Anne-Sophie Le Guern, Eric Bertherat, Maherisoa Ratsitorahina, André Spiegel, Laurence Baril†, Minoarisoa Rajerison†, Simon Cauchemez†
† Ces auteurs ont contribué à parts égales à ce travail.
* Auteur correspondant.
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001736
Une étude conduite dans le cadre du projet Afriobiota qui implique plusieurs membres du Pasteur Network, en collaboration avec l’Université de Lausanne, décrypte le lien entre l’écosystème intestinal et les retards de croissance qui affectent les enfants dénutris. Les résultats de ces travaux ayant inclus près de 1000 enfants âgés de 2 à 5 ans entre 2016 et 2018 sont publiés dans la revue PNAS.
Chez les enfants, la dénutrition – c’est-à-dire la consommation et/ou l’assimilation insuffisante de nourriture pour couvrir les besoins de l’organisme – se manifeste principalement par des retards de croissance. Ces derniers toucheraient, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 22% des moins de 5 ans à l’échelle mondiale (estimation pour l’année 2020).
Cette étude s’intéresse au rôle des communautés microbiennes intestinales (microbiote) dans la dénutrition. Conduite au sein du Pasteur Network, cette recherche a été coordonnée par le Pr Philippe Sansonetti, et menée pendant six ans par l’Institut Pasteur en collaboration avec l’Institut Pasteur de Madagascar et l’Institut Pasteur de Bangui dans le cadre du projet Afriobiota soutenu par la Fondation Total. Les travaux, réalisés à Madagascar et en République centrafricaine auprès de 1000 enfants âgés de 2 à 5 ans, ont mis en évidence que plus de 80% des sujets avec un retard de croissance présentent une pullulation bactérienne anormale dans l’intestin grêle (small intestinal bacterial overgrowth, SIBO). Il s’agit plus spécifiquement de bactéries initialement présentes dans la bouche qui prolifèrent dans l’intestin grêle. À l’aide de modèles expérimentaux (des cultures de cellules et des souris), les chercheurs ont montré que ce phénomène freine l’assimilation des lipides. Cette malabsorption des graisses pourrait en partie expliquer le retard de croissance dont souffrent les enfants.
Pour aller plus loin :
Stunted children display ectopic small intestinal colonization by oral bacteria, which cause lipid malabsorption in experimental models
PNAS, 05 octobre 2022.
Pascale Vonaesch*, João R. Araújo, Jean-Chrysostome Gody, Jean-Robert Mbecko, Hugues Sanke, Lova Andrianonimiadana, Tanteliniaina Naharimanananirina, Synthia Nazita Ningatoloum, Sonia Sandrine Vondo, Privat Bolmbaye Gondje, Andre Rodriguez-Pozo, Maheninasy Rakotondrainipiana, Kaleb Jephté Estimé Kandou, Alison Nestoret, Nathalie Kapel, Serge Ghislain Djorie, B. Brett Finlay, Laura Wegener Parfrey, Jean-Marc Collard, Rindra Vatosoa Randremanana, Philippe J. Sansonetti* and The Afribiota Investigators
* Auteurs correspondants.
https://doi.org/10.1073/pnas.2209589119
Flash Recherche de l’Université de Lausanne